Une solution fondée sur la nature, essentielle face aux changements climatiques
« Préserver la biodiversité c’est aussi nous préserver »
Office français de la biodiversité

Office français de la biodiversité
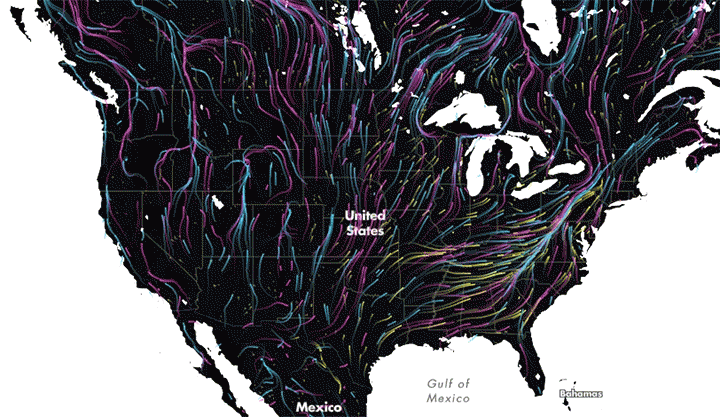
Les corridors écologiques sont des zones terrestres ou aquatiques, formées d’un ou plusieurs milieux naturels distincts. Identifiés et gérés à long terme, ils favorisent la connectivité entre les habitats, permettant aux espèces de circuler, de s’alimenter et de se reproduire. Les corridors s’étendent généralement entre deux « noyaux de conservation ». Ces noyaux sont des territoires protégés (ex. aire protégée, réserve faunique, parc, etc.) ou des points chauds de biodiversité qui assurent l’intégrité écologique des milieux naturels qui le composent et qui permettent la préservation des populations d’espèces fauniques et floristiques y habitant. Plusieurs activités peuvent avoir lieu au sein d’un corridor écologique à condition qu’elles soient réalisées en tenant compte des espèces, des habitats et de la connectivité entre ceux-ci. Ainsi, les corridors ne sont pas des freins au développement économique, mais plutôt une opportunité de redéfinir notre manière d’entreprendre nos activités pour qu'elles soient durables et compatibles avec les processus naturels.
Attention! Il ne faut pas confondre les corridors écologiques avec les passages fauniques qui sont plutôt des structures construites pour favoriser le déplacement de la faune au-dessous ou au-dessus d’obstacles comme des routes. Un passage faunique peut toutefois se retrouver dans le tracé d’un corridor écologique.
L’un des avantages principaux est de favoriser la résilience des espèces face aux changements climatiques. À mesure que le climat se réchauffe, de nombreuses espèces se verront obligées de migrer vers le nord pour retrouver les conditions dont elles ont besoin pour survivre. L’existence d’un réseau de corridors écologiques sera alors critique pour favoriser cette migration d’un milieu naturel à l’autre.
La connectivité écologique n’est pas seulement positive pour les espèces fauniques et floristiques, elle l’est aussi pour les humains. En effet, les milieux naturels offrent une multitude de bienfaits pour notre société, que l’on nomme « services écosystémiques ». La protection de la connectivité protège par le fait même ces services.
Vous avez des questions? Vous trouverez peut-être la réponse dans la Foire aux questions! 👇

Les forêts et milieux humides filtrent les polluants, améliorant ainsi la qualité de l’air et de l’eau potable. Par exemple, les tourbières absorbent les métaux lourds et les toxines, tandis que les arbres captent les particules fines dans l’air.

Les milieux naturels atténuent les effets des changements climatiques en absorbant le CO₂, en limitant les îlots de chaleur urbains et en réduisant les écarts de température. Les rivières et les zones boisées contribuent également à maintenir une humidité et une température plus stables dans leur environnement immédiat.

Les racines des arbres et la végétation riveraine stabilisent les sols et limitent l’érosion des berges. Les milieux humides agissent comme des éponges naturelles, retenant l’eau lors des fortes pluies et réduisant ainsi le risque d’inondations dans les zones habitées.

Les espaces naturels offrent des lieux propices à la détente et à diverses activités récréatives (ex. randonnée, canot, etc.). Ils contribuent au bien-être mental et physique des citoyen(ne)s tout en favorisant un sentiment d’appartenance à la nature et à son territoire.
Ce phénomène de réduction de la taille des îlots forestiers compromet l’intégrité des écosystèmes
Accentue la prédation;
Facilite l’introduction d’espèces envahissantes;
Modifie les conditions écologiques (luminosité, humidité, température) aux abords des zones déboisées.
Certaines espèces, comme l’orignal, souffrent particulièrement de cette fragmentation, car elles ont besoin de vastes territoires forestiers ininterrompus pour se nourrir et se déplacer.
Dans le sud, l’étalement urbain, le développement routier et l’agriculture grignotent progressivement les milieux naturels.
Dans le nord, ce sont principalement les coupes forestières et l’aménagement de routes d’accès pour l’exploitation des ressources qui fragmentent le paysage.
Une étude récente sur la connectivité écologique des Basses-terres du Saint-Laurent (province naturelle qui inclut le sud de l’Outaouais) a révélé qu’entre 2011 et 2021, la surface boisée totale avait augmenté (Oehri et al., 2024). Cependant, derrière cette bonne nouvelle se cache une réalité plus préoccupante : la taille moyenne des parcelles forestières a diminué, compromettant ainsi la connectivité des habitats.
La fragmentation est donc un enjeu majeur pour le sud de notre région, nécessitant une réflexion approfondie sur l’aménagement du territoire afin de préserver nos écosystèmes et la faune qui en dépend!
Conservation de la nature Canada a initié l’Initiative québécoise Corridors écologiques (IQCÉ) en 2017. Celle-ci a lieu dans onze régions du Québec, dont l’Outaouais, et elle vise à proposer une « approche collective de l’aménagement du territoire », centrée sur la conservation de la connectivité écologique à travers la mise en place de corridors écologiques inter-régions.
Crédit vidéo : Conservation de la nature Canada (CNC)
Les Orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT) définissent les grandes lignes à suivre pour guider les municipalités et les MRC du Québec dans leur planification territoriale. Mises à jour en 2024 par le gouvernement provincial, ces orientations remplacent une version devenue obsolète et visent à mieux répondre aux défis actuels du territoire.
Désormais, les municipalités doivent accorder une attention particulière aux enjeux environnementaux. Parmi les priorités figurent la résilience aux changements climatiques (Orientation 1) et la conservation des écosystèmes (Orientation 2). Chaque orientation est déclinée en objectifs et attentes spécifiques. Par exemple, l’une des attentes de la deuxième orientation encourage le maintien et le rétablissement de la connectivité écologique afin d’assurer la pérennité des espèces.
Depuis plusieurs années le CREDDO initie de nombreux projets en lien avec la connectivité écologique.
Voici quelques-unes de nos actions récentes.

Depuis septembre 2024, le CREDDO, en tant que maître d’œuvre de l’IQCÉ en Outaouais, a mis sur pied le Groupe de travail sur la connectivité écologique en Outaouais (GTCO). En plus de contribuer à la démarche de l’IQCÉ, le GTCO découle du volet connectivité du grand projet régional Kidjimaninan qui est piloté par la communauté Kitigan Zibi Anishinabeg. L’objectif du GTCO est d’identifier et de conserver les corridors écologiques essentiels au déplacement de la faune et à la préservation des écosystèmes à l’échelle régionale.
Le projet est présenté plus en détails sur la page web qui lui est dédiée.

Aussi sous le parapluie de l’IQCÉ, la zone de connectivité Plaisance-Tremblant est un projet en collaboration avec Éco-corridors laurentiens, Conservation de la nature Canada et Canards Illimités Canada pour améliorer la connectivité entre le Parc de Plaisance et celui du Mont-Tremblant. À cet effet, un plan de connectivité est élaboré à l’heure actuelle pour prévoir des actions et une gouvernance propice à l’atteinte de ce but.
Le projet est présenté plus en détails sur la page web qui lui est dédiée.
Ces boîtes à outil ont été créées afin que les différents acteurs impliqués dans l’aménagement du territoire puissent contribuer à la conservation des milieux naturels et des corridors écologiques.

Pour les MRC - cliquez ici
Pour les municipalités - cliquez ici
Pour les intervenants en forêt privée - cliquez ici
Pour tous les publics - cliquez ici

Corridors écologiques et aménagement - Nature Action Québec
Les corridors écologiques : Solutions naturelles pour la biodiversité et l’adaptation aux changements climatiques - Nature Action Québec et Centre de la Nature Mont Saint-Hilaire

Plateforme StopCarcasses - iNaturalist.ca
Plateforme StopCarcasses - Outaouais - iNaturalist.ca

Cartographie participative des corridors écologiques potentiels du sud de l'Outaouais - Felt.com
Vidéo tutoriel d’utilisation d’une carte interactive sur Felt.com
Carte interactive des projets en connectivité au Québec - Connectivitéécologique.com

Le Groupe de travail sur la connectivité écologique en Outaouais a été réalisé dans le cadre du projet Accélérer la conservation dans le sud du Québec (ACSQ), un projet de cofinancement dont le gouvernement du Québec y a investi plus de 144 M$ et en a confié la gestion à Conservation de la nature Canada. Le projet Kidjimaninan de la communauté Kitigan Zibi Anishinabeg a également contribué financièrement à la démarche de GTCO.
Ce projet est réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, dans le cadre du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.